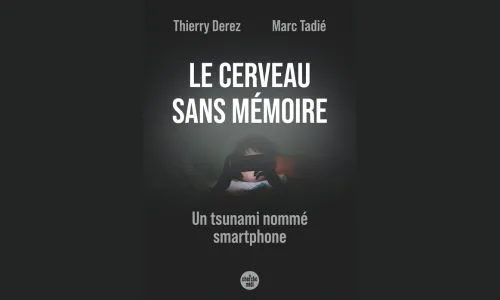« Le smartphone est un outil prodigieux... à condition de ne pas en devenir l'esclave », avertit Marc Tadié, neurochirurgien. L'omniprésence du téléphone dans nos vies n'est plus une simple question de confort ou de connectivité. Elle devient une question de santé publique. Dans le livre Le cerveau sans mémoire – Un tsunami nommé smartphone (éditions Le cherche midi), Marc Tadié et le professeur Thierry De Reys, avocat et dirigeant d'un groupe d'assurances, lancent l'alerte.
À travers des recherches scientifiques, des constats cliniques et un regard humaniste, ils décryptent les effets délétères d'un usage excessif du numérique, en particulier chez les plus jeunes et les personnes en situation de handicap. Sans diaboliser l'outil, ils invitent à en faire un usage raisonné, intelligent et surtout conscient. Marc Tadié expose les grandes lignes de cet essai documenté, accessible et humain, paru le 2 septembre 2025, dans un entretien passionnant accordé à Handicap.fr.
Handicap.fr : Quel est l'objectif de votre livre Le cerveau sans mémoire – Un tsunami nommé smartphone ?
Marc Tadié : Avec mon co-auteur Thierry De Reys, nous avons été frappés par la fascination croissante de nos contemporains pour les outils numériques. Nous nous sommes demandé si cette transformation des comportements - que l'on observe partout, dans la rue, au restaurant, dans les transports - pouvait correspondre à une transformation plus profonde du cerveau. La réponse est oui.
Derrière le simple usage du smartphone se cache une évolution cognitive majeure, que nous avons pu documenter grâce à des recherches scientifiques, des tests psychologiques et surtout l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM). Le cerveau est aujourd'hui modifié, physiologiquement, par notre usage du numérique. D'où l'urgence d'écrire : pour alerter, prévenir et proposer des pistes d'action. Par ailleurs, les droits d'auteur seront entièrement reversés à l'Institut pour la recherche sur la moelle épinière et le cerveau.
H.fr : Quels sont les effets concrets d'un usage excessif du smartphone sur notre cerveau ?
MT : Le premier impact, fondamental, concerne la mémoire. Le cerveau, tel un muscle, a besoin d'exercice pour maintenir ses fonctions. Moins on sollicite sa mémoire, plus elle s'atrophie. Or, aujourd'hui, nous déléguons au smartphone une grande partie de nos souvenirs, de nos repères, de notre mémoire quotidienne : numéro de téléphone, rendez-vous, adresses, souvenirs visuels… tout est stocké ailleurs.
Résultat : les zones du cerveau dédiées à la mémoire, comme l'hippocampe, perdent en volume, en densité, en efficacité. Et, avec la mémoire, s'effondrent d'autres fonctions : l'attention, l'imagination, la capacité à faire des liens. C'est toute la vie mentale qui se trouve affaiblie.
H.fr : L'imagerie cérébrale confirme donc ces transformations ?
MT : Absolument. On a longtemps parlé du cerveau en termes théoriques. Mais, aujourd'hui, grâce aux outils d'imagerie, nous pouvons visualiser l'atrophie réelle de certaines régions cérébrales. L'exemple le plus frappant est celui des chauffeurs de taxi londoniens. Avant l'arrivée du GPS, ils devaient mémoriser la totalité du plan de Londres, ce qui renforçait leur hippocampe, siège de la mémoire spatiale. Depuis l'usage systématique des GPS, cette région s'est réduite chez eux, comme chez le reste de la population.
H.fr : Ces effets sont-ils réversibles ?
MT : Partiellement, et à condition d'intervenir à temps. Le cerveau a une grande plasticité, mais elle diminue avec l'âge et l'intensité du dommage. Un réseau cérébral non sollicité s'affaiblit. Au bout d'un certain temps, il devient inactif, puis inopérant. Il ne suffit plus de « réactiver », il faut alors en créer de nouveaux - ce qui demande beaucoup plus d'efforts.
C'est comme une voie ferrée abandonnée : si vous ne l'entretenez pas, les herbes la recouvrent, les rails rouillent ; à terme, elle disparaît. Il faut donc faire un vrai travail quotidien de stimulation de la mémoire pour maintenir ces fonctions actives.
H.fr : Alors, comment conserver sa mémoire ?
MT : En recréant une hygiène cognitive. Chaque jour, je recommande de faire cinq à six actes de mémoire sans recourir au smartphone : retenir un code, une adresse, un numéro de téléphone, mémoriser un rendez-vous, etc. Je suis frappé par tous ces automobilistes qui prennent le numéro de leur place de parking en photo au lieu d'essayer de le retenir.
Il faut aussi redonner de la place à la lecture, aux échanges en présentiel, à la marche, à la contemplation. Toutes ces expériences nourrissent le cerveau.
H.fr : À partir de quand peut-on parler d'addiction au smartphone ?
MT : Quand il devient impossible de s'en passer. Ce n'est pas une question de durée d'utilisation mais de dépendance comportementale. Si vous êtes incapable de quitter une pièce sans votre téléphone, si vous retournez le chercher systématiquement, si vous le consultez compulsivement sans raison… c'est mauvais signe !
Le mécanisme est le même que pour une drogue. Le cerveau sécrète de la dopamine, hormone du plaisir, à chaque stimulation via le smartphone : une notification, un message, une vidéo. Plus vous utilisez votre téléphone, plus vous avez envie de l'utiliser. C'est un cercle vicieux. Et il est d'autant plus pernicieux qu'il est socialement accepté, voire encouragé, contrairement à la drogue par exemple.
H.fr : Peut-on parler d'un nouveau type de handicap créé par le numérique ?
MT : C'est effectivement une nouvelle forme de handicap, provoquée par un excès de technologie, et surtout par une sous-utilisation de nos fonctions naturelles. En Allemagne, on parle déjà de « démence digitale » pour désigner ces effets : perte de mémoire, troubles de l'attention, repli sur soi. Ces symptômes, proches de ceux de la maladie d'Alzheimer, apparaissent parfois chez des trentenaires alors qu'ils ne concernaient auparavant que des personnes de 70 ans. C'est extrêmement préoccupant.
H.fr : Pourtant, le numérique est souvent présenté comme un levier d'inclusion, notamment pour les personnes en situation de handicap.
MT : Et c'est vrai. C'est tout le paradoxe. Chez les personnes âgées ou en situation de handicap, le smartphone peut être un outil formidable. Il permet de rompre l'isolement, de stimuler la mémoire, de maintenir un lien social. Il offre un accès à l'information, à la culture, à la communication. Le danger apparaît quand le smartphone remplace des fonctions actives, au lieu de les soutenir. Chez une personne « valide », il doit rester un outil, pas un substitut à l'attention ou à l'interaction humaine. Chez une personne handicapée, il peut être un pont. Mais il ne faut jamais perdre de vue cette frontière.
H.fr : Dans votre livre, Martin, adolescent paraplégique, incarne précisément cette ambivalence.
MT : Absolument. Au début du livre, il est complètement vampirisé par son téléphone. Il l'utilise notamment pour masquer son handicap sur les réseaux sociaux, où il ne montre que le haut de son corps. Le smartphone devient alors un outil d'illusion qui lui permet de se construire une identité virtuelle, déconnectée de sa réalité physique.
Mais, progressivement, son rapport à l'outil évolue. Martin découvre qu'il peut aussi l'utiliser comme un levier pour avancer et non pour se dissimuler. Il accède à des applications de rééducation, à des ressources en ligne, à l'intelligence artificielle, qui lui ouvrent de nouvelles possibilités d'apprentissage et d'autonomie. Il comprend que le numérique peut être un outil d'émancipation plutôt qu'une échappatoire.
H.fr : Comment, en tant que parent, protéger ses enfants de cette dépendance ?
MT : D'abord, en posant des règles claires : pas de smartphone à table, pas d'écran avant de dormir. L'exposition à la lumière bleue perturbe le sommeil, et donc la mémoire, la concentration, l'humeur.
Le rôle des parents est de guider, pas seulement de contrôler : il faut expliquer, proposer des alternatives, encourager les usages intelligents. Il existe des applications qui stimulent la mémoire, développent l'imagination. Et cela vaut pour tous les enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Le smartphone doit être un outil d'ouverture, pas un enfermement.
H.fr : Vous parlez d'un « scandale sanitaire de demain ». Selon vous, l'addiction numérique est comparable aux grandes crises de santé publique, comme celles liées au tabac ou à l'amiante ?
MT : Oui, les signaux sont là : atrophie cérébrale visible, troubles cognitifs précoces, montée des troubles anxieux et dépressifs, perte du lien social. Nous sommes face à une crise silencieuse. Et, comme dans ces crises, les intérêts économiques freinent la prise de conscience. Pourtant, certains pays commencent à réagir. On évoque des restrictions d'usage, des chartes éducatives, des campagnes d'information. Il faut aller plus loin.
H.fr : L'État et les acteurs du numérique ont-ils, selon vous, une responsabilité dans la prévention de ce risque ?
MT : L'État a un rôle clé à jouer en matière de santé publique. Il pourrait par exemple lancer des campagnes de sensibilisation, dès l'école, ou encore exiger des plateformes numériques qu'elles intègrent des outils de contrôle, d'alerte, de prévention. Et pourquoi pas, imposer des bandeaux du type « Pour préserver votre mémoire, limitez votre usage quotidien ».
À la télé aussi, on pourrait imaginer la diffusion de messages de prévention : « Pour votre santé mentale, utilisez votre mémoire chaque jour. » Aujourd'hui, aucune publicité de smartphone ne comporte ce type d'avertissement. C'est un manque criant.
H.fr : Pour résumer, comment faire du smartphone un allié plutôt qu'un « maître », et quels usages positifs méritent d'être encouragés ?
MT : Le smartphone, utilisé à bon escient, peut être un outil formidable : d'accès à l'intelligence artificielle, d'ouverture à l'imaginaire, de lien social, de stimulation cognitive, en particulier chez les personnes âgées ou en situation de handicap. En médecine, il peut même contribuer à affiner des diagnostics ou enrichir la rééducation.
Mais il ne doit jamais remplacer notre cerveau – seulement l'enrichir. Cela me surprend toujours de voir des personnes avec leur téléphone suspendu autour du cou, comme une sorte de laisse. Le symbole est fort : c'est l'humain qui est attaché à son appareil.
Avant de photographier un lieu, regardons-le. Avant de poser une question à l'IA, tentons d'y répondre par nous-mêmes. Le smartphone doit rester un outil de stimulation, pas de substitution. Il faut savoir refermer l'écran… pour ouvrir son cerveau.
© Couverture du livre